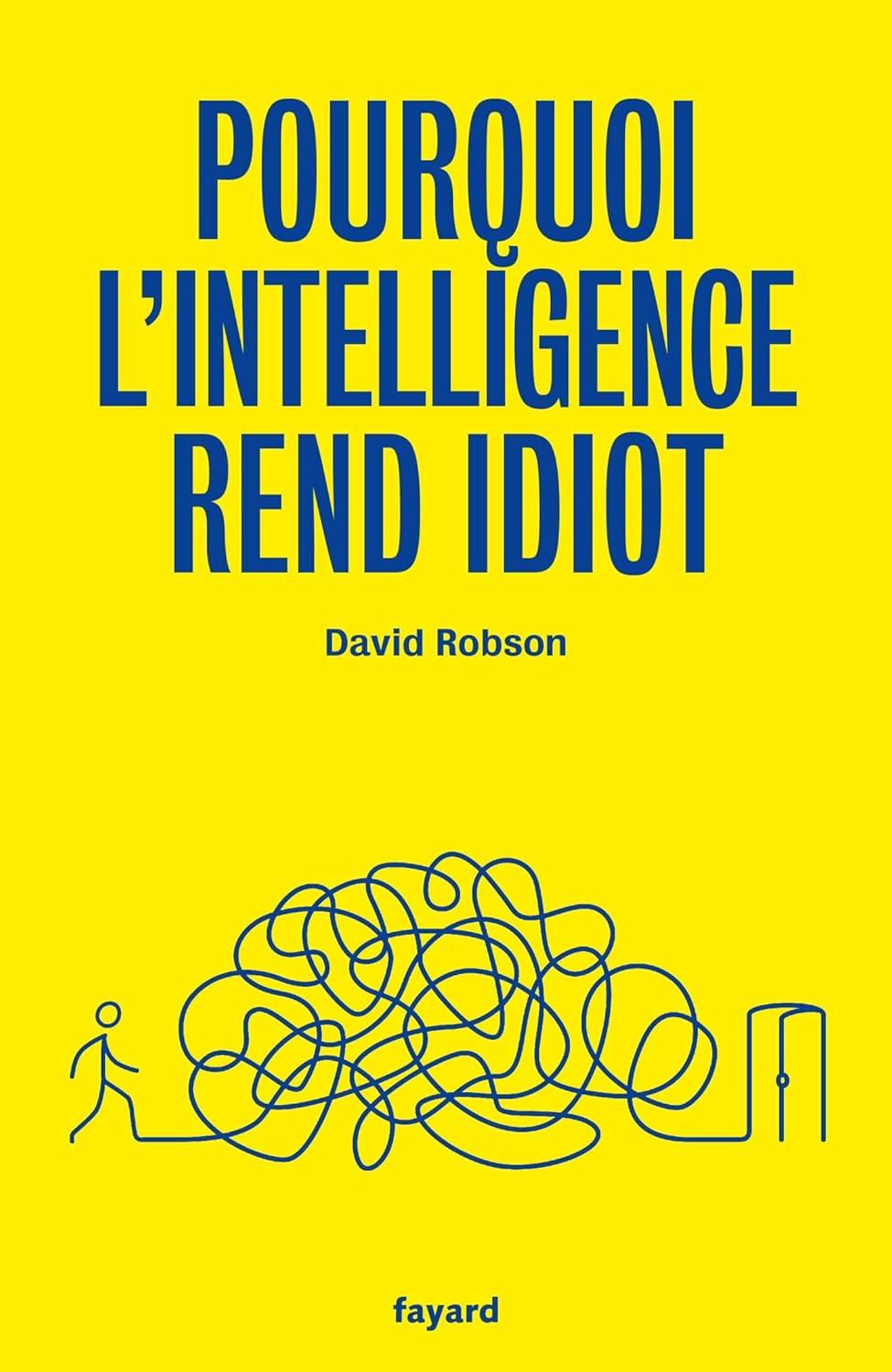Plus on est intelligent, plus de choses on connaît, plus on a de l’expérience … meilleures seront nos décisions et moins on se trompe.
Logique, non ?
A l’apparence, oui. Sauf que c’est faux.
L’histoire regorge d’exemples de génies dont les décisions catastrophiques ont bouleversé leur vie privée, leur entreprise, voire même leur pays.
On pourrait les écarter vite en pensant que c’est de cas isolés. Malheureusement, pléthore d’expériences scientifiques, et situations dans la vie réelle, démontrent qu’il ne s’agit pas d’exceptions.
Toi aussi, que tu sois un génie ou pas, tu tombes régulièrement dans ces erreurs.
Dans certaines conditions, non seulement l’intelligence et l’expérience ne nous protègent pas d’erreurs graves. Elles peuvent même en être la raison principale.
Être intelligent c’est comme avoir une voiture avec un moteur surpuissant. La voiture peut aller très vite, certes. Mais si tu ne sais pas la conduire correctement, ou si tu ne connais pas ta destination, tu risques d’arriver plus vite … au mauvais endroit. Voir carrément de sortir de route.
Dans cet article, tu vas découvrir les bonnes stratégies pour identifier les pièges qui t’empêchent de prendre les bonnes décisions, et comment les éviter.
Pourquoi l’intelligence rend idiot de David Robson
Pendant des décennies, on a cru que l’intelligence était un facteur déterminant dans plusieurs domaines de notre vie, comme les études ou la réussite professionnelle. On pensait même pouvoir la mesurer de manière précise et objective, grâce à un seul chiffre : le célèbre Quotient Intellectuel.
Pendant longtemps, les tests de QI, censés identifier les candidats les plus brillants et prédire leur performance et succès futur, ont servi de passeport pour les universités et les entreprises les plus prestigieuses.
Mais peu à peu, des preuves contraires à cette vision se sont cumulées. Le lien entre le QI et les résultats concrets dans la vie ou dans le travail n’était pas si évident que cela. Être intelligent, au sens académique du terme, ne suffit pas pour bien décider, ni pour réussir.
De la même manière, l’éducation ou même l’expérience n’aident pas toujours à faire le bon choix.
C’est de ce paradoxe que part David Robson dans son livre « Pourquoi l’intelligence rend idiot ».
Il démontre que, dans certaines situations, non seulement l’intelligence ne nous protège pas des erreurs. Mais si elle n’est pas accompagnée d’autres qualités comme l’humilité intellectuelle, la curiosité ou l’ouverture d’esprit, elle peut même en être la cause.
Dans cette vidéo, je te propose de découvrir les stratégies concrètes que l’auteur propose pour transformer notre intelligence dans une véritable sagesse pratique.
1. Pourquoi les personnes intelligentes font-elles des erreurs ?
Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi, dans certains cas, plus on est intelligent, plus on risque de tomber dans des pièges mentaux.
La première raison est que celle que nous appelons habituellement « intelligence » reflète seulement un sous-ensemble de nos capacités mentales : elle se concentre sur la réflexion analytique et abstraite, celle qui nous permet de résoudre des problèmes logiques ou de manipuler des concepts.
Mais cette forme d’intelligence, souvent mesurée par les tests de QI, ne dit rien de notre capacité à gérer la complexité de la vie réelle.
D’autres formes d’intelligence — comme l’intelligence pratique, sociale ou émotionnelle, et créative — sont tout aussi cruciales pour bien réfléchir et prendre des bonnes décisions :
- Par exemple, l’intelligence pratique aide à comprendre les situations concrètes et à adapter nos décisions au contexte.
- L’intelligence sociale et émotionnelle, quant à elles, permettent de décoder les intentions, les émotions et les motivations des autres.
- L’intelligence créative nous permet d’innover et d’imaginer des solutions inédites face à un problème.
Il n’y a pas une forme d’intelligence meilleure que les autres. Chacune s’adapte bien à des contextes particuliers. Donner trop d’importance à un seul type, l’intelligence analytique par exemple, et sous-estimer les autres, est une erreur classique des “esprits brillants”.
La deuxième raison à la base du piège de l’intelligence concerne les biais cognitifs. Ce sont des raccourcis mentaux qui nous facilitent la vie dans une grande majorité de cas, mais qui parfois peuvent nous conduire à des erreurs systématiques de raisonnement. Et paradoxalement, plus on est intelligent, plus on risque d’y tomber.
Un exemple emblématique est le biais de confirmation : la tendance à chercher et valoriser les informations qui confirment ce que nous croyons déjà, tout en ignorant ou en rejetant celles qui le contredisent.
Ainsi, l’intelligence peut se retourner contre nous : plus on est intelligents, plus on arrive à trouver des arguments solides en support de nos idées — même quand elles sont fausses.
Ou encore, la mauvaise utilisation de notre intuition — ce que Daniel Kahneman appelle le Système 1, notre mode de pensée rapide, automatique et instinctif. En opposition au Système 2, délibéré mais lent, le Système 1 fonctionne sans que nous en ayons conscience, en s’appuyant sur des impressions et des associations automatiques.
Il est efficace dans les situations simples de la vie quotidienne, mais sans une utilisation judicieuse, il risque de devenir dangereux car il nous pousse à croire que nos jugements instinctifs sont forcément justes.
C’est ce que l’auteur appelle la dysrationalia : l’utilisation de notre intelligence pour justifier des décisions intuitives erronées, au lieu de les remettre en question.
Certaines personnes seraient tentées de penser que ces limites sont les résultats d’une intelligence trop académique, théorique, mal adaptée à la vie réelle.
Malheureusement, même une connaissance approfondie du terrain ne nous protège pas de certains pièges.
En effet, plus on devient expert sur un sujet, plus on développe de réflexes qui nous permettent de trier vite entre les éléments importants, et les détails inutiles.
Dans la plupart des cas, cette approche est extrêmement efficace. Mais en même temps, elle nous pousse à fonctionner en pilote automatique ; elle nous rend aveugles aux signaux faibles ou les indices contradictoires. Paradoxalement, plus nous sommes experts, plus nous devenons vulnérables aux erreurs grossières.
Un autre défaut classique associé à l’expertise est l’excès de confiance dans son propre jugement.
C’est ce que l’on appelle le dogmatisme mérité : plus on a atteint des résultats brillants grâce à notre expertise et à notre intelligence, plus on est convaincus que notre point de vue est exact.
On risque de tomber dans un sentiment de supériorité intellectuelle, qui nous rend aveugles à nos limites.
2. Les compétences indispensables pour éviter les pièges
Si on s’intéresse autant aux faiblesses de l’intelligence analytique ou de l’intuition, ce n’est pas pour les rejeter. C’est justement d’apprendre à les utiliser de la manière la plus efficace pour aider à prendre des meilleures décisions dans notre vie personnelle, ou dans notre profession.
C’est l’approche poussée par l’auteur, dans ce qu’il appelle la sagesse fondée sur les preuves.
L’idée c’est de combiner logique et instinct de manière efficace est équilibrée, afin d’éviter les erreurs de jugement.
Pour développer notre sagesse fondée sur les preuves, nous devons cultiver 3 compétences. Il s’agit de la prise de décision, l’autoréflexion, et la réflexion cognitive.
Selon Robson, une prise de décision efficace repose sur un équilibre subtil entre raisonnement rationnel et intuition éclairée.
Nous devons garder à l’esprit que, même si nous sommes 100% convaincus d’avoir raison, il existe toujours la possibilité que l’on se trompe, que notre raisonnement et notre intuition puissent être impactés par des biais ou des travers, et que nous sommes aveugles à l’erreur.
Nous devons toujours garder une attitude d’humilité intellectuelle.
Un outil simple que tu peux utiliser pour améliorer tes décisions est la méthode d’algèbre morale, utilisée par Benjamin Franklin. Cette méthode consiste à dresser deux colonnes : d’un côté les arguments pour, de l’autre les arguments contre une décision. Note chaque point qui te vient à l’esprit, sans te censurer. Ne te précipite pas tout de suite sur les étapes suivantes, laisse-toi quelques jours pour faire ressortir les éléments qui ont besoin d’un peu plus de temps pour émerger.
Ensuite, hiérarchise tous les éléments de ces deux colonnes par ordre d’importance. Une fois la liste ordonnée, efface les éléments de poids équivalent dans les deux listes.
De cette manière, tu pourras ne garder que les facteurs réellement décisifs qui vont t’orienter dans une direction ou dans l’autre.
L’autoréflexion est la compétence qui nous permet d’utiliser notre intuition de la bonne manière pour prendre nos décisions. Cela nécessite de bien comprendre les émotions que nous ressentons, afin de faire le tri entre celles utiles à considérer, et celles qui au contraire risquent de nous amener dans une mauvaise direction.
La première étape consiste à développer l’interoception, c’est-à-dire la capacité à percevoir et interpréter les signaux internes du corps : le rythme cardiaque, la respiration, la tension des muscles. Ces signaux sont les tous premiers indices d’une émotion, avant qu’elle soit perçue par notre conscience.
Observer ses sensations te permet de comprendre comment ton corps réagit face à une situation, un choix ou une personne.
La deuxième étape est d’apprendre à distinguer les émotions. Souvent, on a beaucoup de mal à distinguer les émotions que l’on ressent. On confond colère et frustration, tristesse et fatigue, joie et excitation. Plus nous arrivons à distinguer finement les émotions que nous ressentons, mieux nous pouvons comprendre le message qu’elles véhiculent.
Enfin, la troisième étape consiste à réguler les émotions. Il ne s’agit pas de les réprimer, mais de les canaliser pour qu’elles servent la décision, plutôt que l’imposer. Des techniques comme la respiration consciente, la pause réflexive ou le changement de perspective aident à retrouver de la distance saine avec ses propre émotions, et rétablir l’équilibre émotionnel avant d’agir.
Il y a deux pratiques simples que tu peux adopter dans ton quotidien pour renforcer l’autoréflexion :
- La méditation en pleine conscience, qui entraîne l’attention à se connecter au corps et à revenir au moment présent
- Et le journaling (ou écriture réflexive), qui aide à clarifier ses pensées et à observer l’évolution de ses émotions dans le temps.
La réflexion cognitive est la compétence qui nous permet de prendre du recul sur nos pensées et déjouer des éventuels biais. Comme pour les émotions, il est essentiel de prendre une certaine distance avant de juger ou d’agir.
Avant d’accepter une idée, qu’elle vienne de notre esprit ou de quelqu’un d’autre, nous avons intérêt à ralentir, nous poser des questions et examiner les preuves et les faits qui soutiennent cette idée.
Il y a 3 habitudes essentielles à développer dans notre mode de pensée :
1️. Questionner ses intuitions. Avant d’accepter une idée, demande-toi : Pourquoi je crois cela ? Sur quoi je me base ? Si l’idée vient de quelqu’un d’autre, tu peux te poser la question : Qui fait cette affirmation ? Quelle est sa crédibilité et quelles peuvent être ses motivations ?
2️. Chercher activement les contre-arguments. Mets de la distance entre toi, ton identité, et ce que tu penses. Remettre en question ses convictions n’est pas un échec, mais une preuve de maturité. Prends le temps de lire, écouter ou discuter avec des personnes qui ne partagent pas ton avis. Pose-toi ces questions : Existe-t-il d’autres explications possibles ?Quelles informations supplémentaires devrais-je chercher avant de me faire un avis ?
3️. Vérifier les faits et les sources. Avant d’accepter une idée comme vraie, résiste les pièges classiques de la manipulation, comme l’autorité, la familiarité ou la popularité. Voici quelques questions à te poser : Sur quelles bases repose cette affirmation ? Y a-t-il des présupposés douteux ? Et comment se comparent-elles aux preuves contraires ?
3. Allier intelligence et sagesse
Améliorer ses décisions et éviter les pièges des biais cognitifs grâce à la sagesse fondée sur les preuves ne veut pas dire renoncer à l’intelligence analytique, ni à l’intuition.
Au contraire : tu as tout intérêt à les marier pour tirer parti de leurs forces respectives.
Pour que ce mariage fonctionne, trois attitudes jouent un rôle clé : la curiosité, l’état d’esprit de croissance, et la difficulté désirable dans l’apprentissage.
La curiosité est ce qui nous pousse à explorer, à poser des questions et à remettre en cause nos certitudes. C’est la motivation à la base d’un apprentissage et une amélioration continus, indépendamment des résultats ou des facilités à court terme. Être curieux nous aide à chercher constamment des informations nouvelles, y compris celles qui contredisent nos opinions.
L’état d’esprit de croissance est la marque de fabrique de la psychologue et chercheuse Carol Dweck. C’est la croyance que notre intelligence, comme n’importe laquelle de nos autres qualités, n’est pas figée. Elle peut se développer grâce à l’exercice et à l’effort. Dans ce cadre, leurs erreurs ne sont pas vues comme des échecs, mais comme des opportunités d’apprentissage.
Et pour terminer, nous avons intérêt à revoir la manière dont nous apprenons des nouvelles choses, en y ajoutant volontairement une dose de difficulté, par exemple espacer les révisions, varier les contextes, se tester régulièrement.
Ces « difficultés désirables » obligent le cerveau à travailler plus en profondeur. Même si nous avons l’impression d’avancer moins vite à court terme, cela nous permet d’améliorer la compréhension et la mémorisation à long terme.
Voilà, tu sais désormais qu’être intelligent, avoir un quotient intellectuel élevé, n’exclue pas de tomber victime des pièges et des biais cognitifs, ce qui peut parfois amener à prendre des très mauvaises décisions.
Dans son livre « Pourquoi l’intelligence rend idiot », David Robson nous montre l’importance de cultiver curiosité, ouverture d’esprit et humilité intellectuelle, afin d’améliorer sensiblement nos capacités de raisonnement, et éviter ainsi les erreurs les plus dangereuses.
L’idée n’est pas de contraposer intelligence et sagesse, mais de les combiner afin de profiter de leurs forces respectives.
Et toi ? Es-tu particulièrement vulnérable à un de ces pièges ?
Est-ce que t’as envie de cultiver plus de sagesse pratique dans ta vie ?
Si tu souhaites entreprendre un véritable chemin de croissance et épanouissement personnel, je t’invite à rejoindre le nouvel espace dédié à la communauté Mind Parachutes.
Tu vas y trouver des ressources exclusives et des personnes passionnés qui vont te comprendre et te soutenir.